CHORANCHE
Journée terrible sur les bords
de la Bourne et de l'Isère : le 8 mars 1944
Le 8 mars 1944, quatre maquisards quittent Vinay, dans un véhicule, avec l’intention de se rendre aux anciens camps C3 (Autrans) et C5 (Méaudre), qui viennent d’être abandonnés.
- Marcel Bilcke, 27, lieutenant, chef du camp C5.
- Jean-Marie Ruettard, 31, chasseur alpin, chef du camp C3.
- Marc Broyer, 27, membre de C5.
- Florentin Prian, 25, chauffeur à C5.
A l’entrée de Pont-en-Royans (au niveau du cimetière), le véhicule des maquisards est arrêté par un barrage allemand. On découvre un pistolet caché dans le véhicule, et les nazis se mettent à interroger les Français d’une façon brutale. D’après un témoin, ces interrogations se transforment en tortures dans les locaux de la gendarmerie pontoise (qui se situait, à cette époque, aux environs de l’actuel monument aux morts). Les Allemands finissent par quitter Pont-en-Royans en direction de Romans avec les quatre prisonniers, qui sont liés deux par deux avec du fil de fer. Après Saint-Nazaire, entre l’Ecancière et Pizançon (à l’endroit où se situent aujourd’hui les écuries Baracand, un kilomètre avant le pont du Martinet), on quitte la grande route (aujourd’hui, la N532) avec les prisonniers pour faire 400 mètres sur un chemin qui monte à gauche. Les quatre maquisards sont fusillés, et leurs corps sont traînés contre une grange où ils seront retrouvés le lendemain.
Aujourd’hui, une stèle indique l’endroit (dans la commune de Beauregard Baret) où les maquisards ont été fusillés. Elle porte la date de la découverte des corps : le 9 mars 1944. Voici des descriptions sommaires des quatre martyrs :
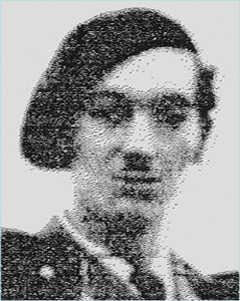 Marcel BILCKE, né le 26 mars 1917 à Rosendael (Nord).
Il choisit la vie militaire et s’engage à 18 ans au 43e RI de Valenciennes. Avec son
régiment, il participe à la bataille de Dunkerque. Après un séjour en Angleterre, il
rejoint son régiment à la caserne St-Charles à Marseille, puis regagne Onnaing (Nord)
où le chef de réseau de la résistance, Legardet, lui confie de nombreuses missions
en 1942 et 1943. Il rejoint le Vercors en 1943, où il devient le responsable du camp C5,
avec le grade de lieutenant. Il est cité à l’ordre de la division, reçoit la croix de
guerre avec palme, la croix de guerre gaulliste, la médaille de la résistance et
la légion d’honneur à titre posthume. Une rue de Petite Synthe porte son nom.
Marcel BILCKE, né le 26 mars 1917 à Rosendael (Nord).
Il choisit la vie militaire et s’engage à 18 ans au 43e RI de Valenciennes. Avec son
régiment, il participe à la bataille de Dunkerque. Après un séjour en Angleterre, il
rejoint son régiment à la caserne St-Charles à Marseille, puis regagne Onnaing (Nord)
où le chef de réseau de la résistance, Legardet, lui confie de nombreuses missions
en 1942 et 1943. Il rejoint le Vercors en 1943, où il devient le responsable du camp C5,
avec le grade de lieutenant. Il est cité à l’ordre de la division, reçoit la croix de
guerre avec palme, la croix de guerre gaulliste, la médaille de la résistance et
la légion d’honneur à titre posthume. Une rue de Petite Synthe porte son nom.
 Jean-Marie RUETTARD, né le 23 décembre 1913 à Lyon (Rhône).
Choisit la carrière militaire. En 1933, après avoir suivi le peleton des
élèves caporaux à Chambéry, il reçoit une première affectation à Lanslebourg,
au 153e RIA. En 1938, il séjourne à St-Maixent. En 1939, il est avec
son régiment sur la ligne Maginot à Morfontaine (Meurthe-et-Moselle). Après des
séjours à Modane en 1941, à Autrans (Isère, section des chasseurs alpins, 1941 et 1942),
il prend en 1943 le commandement du C3 à Autrans avec,
comme « couverture », la fonction de chef d’exploitation de la scierie Barnier. On lui
confie la responsabilité d’aller récupérer les
caractéristiques et les documents de l’avion anglais qui s’est écrasé au Pas de la Clé à
Autrans le 7 février 1944. Il est titulaire à titre posthume de la légion d’honneur,
de la médaille de la résistance et de la croix de guerre avec palme.
Jean-Marie RUETTARD, né le 23 décembre 1913 à Lyon (Rhône).
Choisit la carrière militaire. En 1933, après avoir suivi le peleton des
élèves caporaux à Chambéry, il reçoit une première affectation à Lanslebourg,
au 153e RIA. En 1938, il séjourne à St-Maixent. En 1939, il est avec
son régiment sur la ligne Maginot à Morfontaine (Meurthe-et-Moselle). Après des
séjours à Modane en 1941, à Autrans (Isère, section des chasseurs alpins, 1941 et 1942),
il prend en 1943 le commandement du C3 à Autrans avec,
comme « couverture », la fonction de chef d’exploitation de la scierie Barnier. On lui
confie la responsabilité d’aller récupérer les
caractéristiques et les documents de l’avion anglais qui s’est écrasé au Pas de la Clé à
Autrans le 7 février 1944. Il est titulaire à titre posthume de la légion d’honneur,
de la médaille de la résistance et de la croix de guerre avec palme.
 Marc BROYER, né le 23 février 1917 à Noisy-le-Sec (Seine).
Entré au centre d’apprentissage de la SNCF en 1930, il apprend le métier d’ajusteur.
Il travaille au dépot SNCF d’Audun-le-Roman (54) jusqu’en 1937, puis il effectue son
service militaire dans la marine. Libéré en 1940, il reprend son service à la SNCF
à Verdun. En 1943, réfractaire au STO, il rejoint le maquis du Vercors. Croix de guerre
avec palme, à titre posthume. Une rue d’Audun-le-Roman porte son nom.
Marc BROYER, né le 23 février 1917 à Noisy-le-Sec (Seine).
Entré au centre d’apprentissage de la SNCF en 1930, il apprend le métier d’ajusteur.
Il travaille au dépot SNCF d’Audun-le-Roman (54) jusqu’en 1937, puis il effectue son
service militaire dans la marine. Libéré en 1940, il reprend son service à la SNCF
à Verdun. En 1943, réfractaire au STO, il rejoint le maquis du Vercors. Croix de guerre
avec palme, à titre posthume. Une rue d’Audun-le-Roman porte son nom.
 Florentin PRIAN, né le 5 octobre 1919 à Tambre (Italie).
Originaire d’Italie, sa famille s’installe en Lorraine pour travailler dans les mines.
Mécanicien de métier au garage Citroën de Verdun, il devient naturellement le chauffeur
désigné du C5. Réfractaire au STO, il rejoint le Vercors en 1943. Ses parents, tout à
leur chagrin d’avoir perdu leur seul fils, n’ont pas donné suite à la proposition du
maire de Haudainville de constituer un dossier pour lui faire obtenir la médaille
militaire et la croix de guerre à titre posthume.
Florentin PRIAN, né le 5 octobre 1919 à Tambre (Italie).
Originaire d’Italie, sa famille s’installe en Lorraine pour travailler dans les mines.
Mécanicien de métier au garage Citroën de Verdun, il devient naturellement le chauffeur
désigné du C5. Réfractaire au STO, il rejoint le Vercors en 1943. Ses parents, tout à
leur chagrin d’avoir perdu leur seul fils, n’ont pas donné suite à la proposition du
maire de Haudainville de constituer un dossier pour lui faire obtenir la médaille
militaire et la croix de guerre à titre posthume.